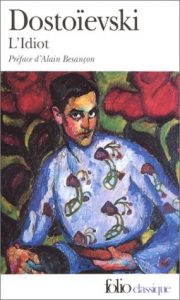Si les problèmes liés à la fin de vie nous préoccupent, le débat touche aujourd’hui davantage au problème de la souffrance quand il s’agissait hier d’un problème religieux. Faute de pouvoir traiter la douleur, nos aïeux n’avaient d’autre choix que de se convertir au stoïcisme.
Les personnages de Dostoïevski reflètent rarement les idées de leur auteur, dans cet extrait le personnage concerné n’en jette pas moins un éclairage intéressant sur la vision d’une époque ou la fin de vie en terme se définissait déjà en termes de morale et liberté que l’on retrouve aujourd’hui encore dans le débat public.
« Voici, d’abord, une étrange idée : de quel droit, au nom de quel principe m’interdirait-on d’abréger une existence limitée maintenant à deux ou trois semaines ? À qui cela importe-t-il ? Qui a besoin que, condamné, j’attende patiemment le jour de l’exécution ? Se peut-il qu’en effet cela soit nécessaire à quelqu’un ? Dira-t-on que la morale l’exige ? Si j’étais robuste et bien portant, je comprendrais encore qu’on m’opposât la rengaine accoutumée : « Vous n’avez pas le droit d’attenter à une vie qui peut être utile à votre prochain », etc. Mais maintenant, maintenant que je suis déjà si près de l’échéance fatale ? Quelle morale a besoin de mon dernier hoquet et pourquoi faut-il que j’expire en écoutant jusqu’au bout les consolations du prince qui, sans doute, ne manquera pas de me démontrer que la mort est même un bienfait pour moi ? (Les chrétiens comme lui en viennent toujours là, c’est leur idée favorite.) Et qu’est-ce qu’ils veulent avec leurs ridicules « arbres de Pavlovsk » ? Adoucir les dernières heures de ma vie ? Comment ne comprennent-ils pas que plus je m’oublierai, plus je m’attacherai à ce dernier fantôme de vie et d’amour par lequel ils veulent me masquer le mur de Meyer et tout ce qui y est si franchement écrit, — plus ils me rendront malheureux ? Que m’importent votre nature, votre parc de Pavlovsk, vos levers et vos couchers de soleil, votre ciel bleu et vos visages toujours contents, si je suis seul exclu de ce banquet sans fin ? De quel intérêt est pour moi toute cette beauté quand, à chaque minute, à chaque seconde, je sais et je suis forcé de savoir que seul j’ai été traité en paria par la nature, alors que la petite mouche qui bourdonne autour de moi dans un rayon de soleil a elle-même sa place au banquet, la connaît et est heureuse ? Oh ! je sais bien, le prince et les autres voudraient, pour le triomphe de la morale, me faire dire, au lieu de toutes ces paroles fielleuses et ulcérées, la célèbre strophe de Gilbert :
Ah ! puissent voir longtemps votre beauté sacrée
Tant d’amis sourds à mes adieux !
Qu’ils meurent pleins de jours, que leur mort soit pleurée,
Qu’un ami leur ferme les yeux !« Mais, croyez-le, braves gens, dans cette poésie résignée, dans cette bénédiction académique donnée au monde en vers français, se cache un fiel si intense, une haine si implacable que le poète s’y est peut-être trompé lui-même et qu’il a pris ses larmes de colère pour des larmes d’attendrissement. Sachez qu’il y a une limite à la honte que l’homme éprouve devant son néant, et que, cette limite dépassée, il trouve une jouissance extraordinaire dans le sentiment de sa faiblesse, de sa nullité… Allons, sans doute, ainsi comprise, l’humilité, je l’admets, est une force énorme, mais ce n’est pas dans ce sens que la religion l’entend.
« La religion ! J’admets la vie éternelle et peut-être l’ai-je toujours admise. Que la conscience soit allumée par la volonté d’une force suprême » qu’elle jette un regard sur le monde et dise : « J’existe ! », puis que tout d’un coup cette force suprême lui ordonne de s’éteindre parce qu’il le faut pour quelque intérêt supérieur, — et même sans lui expliquer pourquoi, soit, j’admets tout cela, mais reste toujours la question : De quelle nécessité ma soumission est-elle ici ? Ne peut-on pas me dévorer sans exiger que je bénisse qui me dévore ? Se peut-il qu’en effet quelqu’un là-haut soit offensé parce que je ne veux pas attendre quinze jours ? Je ne le crois pas, et il est beaucoup plus naturel de supposer que l’on a besoin de ma chétive existence pour compléter quelque harmonie universelle, de même que, chaque jour, sont sacrifiés des millions d’êtres sans la mort desquels le reste du monde ne pourrait subsister. (Il faut noter toutefois qu’il y a là peu de magnanimité.) Mais soit ! Je reconnais qu’il était impossible d’organiser le monde autrement, c’est-à-dire sans que les uns mangeassent les autres ; je consens même à admettre que je ne comprends rien à cette organisation ; seulement voici ce que je sais : du moment qu’on m’a une fois donné la conscience de mon être, que m’importent la vicieuse organisation du monde et l’impossibilité où il est d’exister autrement ? Qui donc, après cela, me jugera et à raison de quoi serai-je jugé ? On aura beau dire, tout cela est impossible et injuste.
« Pourtant, quelque désir que j’en eusse, jamais je n’ai pu me figurer qu’il n’y a ni vie future ni Providence. Le plus probable, c’est que tout cela existe, mais que nous ne comprenons rien à la vie future et à ses lois. Mais s’il est si difficile et même tout à fait impossible de comprendre cela, se peut-il que je sois coupable parce que je n’ai pu concevoir une chose qui dépasse l’entendement ? À la vérité, ils disent et, sans doute, le prince comme les autres, qu’ici la soumission est nécessaire, qu’il faut obéir sans raisonner et que ma docilité sera certainement récompensée dans l’autre monde. Nous rabaissons trop la Providence quand, par dépit de ne pouvoir la comprendre, nous lui prêtons nos idées. Mais, encore une fois, si l’homme ne peut la comprendre, il est inadmissible, je le répète, que cette inintelligence lui soit imputée à crime. Et, s’il en est ainsi, comment donc serai-je jugé pour n’avoir pas compris la véritable volonté et les lois de la Providence ? Non, mieux vaut ne plus parler de la religion.
« D’ailleurs, en voilà assez. Quand j’arriverai à ces lignes, à coup sûr le soleil se lèvera et « commencera à résonner dans le ciel », une force immense, incalculable se répandra sur toute la terre. Soit ! Je mourrai les yeux fixés sur la source de la force et de la vie, et je ne voudrai pas de cette vie ! S’il avait dépendu de moi de ne pas naître, assurément je n’aurais pas accepté l’existence dans des conditions si dérisoires. Mais j’ai encore la faculté de mourir, quoique, mes jours étant comptés, mon pouvoir soit fort mince et par suite, aussi ma révolte.
« Dernière explication : Si je meurs, ce n’est nullement parce que je n’ai pas la force de supporter ces trois semaines ; oh, je serais assez fort pour cela, et, si je voulais, je trouverais une consolation suffisante rien que dans le sentiment de l’injure qui m’est faite ; mais je ne suis pas un poëte français et je ne veux pas me consoler de la sorte. Enfin, il y a là quelque chose de séduisant : en limitant ma vie à trois semaines, la nature a tellement rétréci ma sphère d’action, que le suicide est peut-être le seul acte auquel ma volonté puisse encore présider d’un bout à l’autre. Eh bien, peut-être veux-je profiter de la dernière possibilité d’agir qui me reste ? Parfois une protestation n’est pas une petite affaire… »
Illustration : Hans Holbein le Jeune, Le christ mort, prédelle d’un retable réalisé pour la cathédrale de Fribourg (1521-1523) Kunstmuseum de Bâle